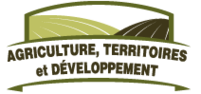Les systèmes alimentaires alternatifs peuvent-ils constituer une voie pour la transition écologique ?

- Période: 2023-04-01 2028-03-31
Titulaire
Aperçu
La durabilité de nos systèmes alimentaires est aujourd'hui beaucoup questionnée compte tenu de leurs impacts sur l'environnement et sur la cohésion sociale. Afin de mieux gérer des ressources (eau, terres, biodiversité) qui s’épuisent, une transition agroécologique est nécessaire. Or, une telle transition pose de nombreux défis liés aux incertitudes et à l’acceptabilité des solutions proposées.
Les chemins que peut prendre la transition agroécologique peuvent être variés, allant d’une désartificialisation et écologisation des pratiques à une technologisation croissante. Parmi les modèles associés à la transition agroécologique, figurent des modèles souvent qualifiés d’alternatifs (par opposition aux modèles conventionnels ou industriels). Ces modèles suscitent autour d’eux de multiples initiatives qui viennent en amont et en aval des systèmes alimentaires : accès au foncier; sociofinancement; formation; conception et auto-construction d’équipements; abattage; fourniture d’intrants; conseil technique; etc. Toutes ces alternatives dessinent une nébuleuse dont les frontières ne sont pas toujours aisées à décrire, mais qui repose sur une « promesse de différence » (Le Velly, 2019).
En mobilisant les apports théoriques et les concepts de la théorie multi-niveaux (MLP) (Geels, 2002), l’objectif de notre recherche est de répondre à la question suivante : dans quelle mesure, les nombreuses initiatives citoyennes et professionnelles observées annoncent-elles une structuration des niches susceptible d’influencer, voire de remplacer le régime dominant, afin de contribuer à la transition agroécologique des systèmes alimentaires québécois ?