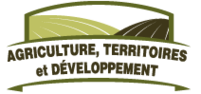Rechercher
Titulaire
Aperçu
Les « fermes de proximité » qui pratiquent la vente directe sans aucun intermédiaire entre le producteur et le consommateur représentaient 21 % de toutes les fermes québécoises en 2021 comparativement à 19 % en 2016 selon les données les plus récentes. Les initiatives de mise en marché rapprochant le consommateur du producteur font l’objet d’un intérêt renouvelé au Québec comme ailleurs, tant de la part des acteurs de l’agriculture que des pouvoirs publics ou des consommateurs. Ces initiatives visent généralement à offrir aux consommateurs une façon alternative d’acquérir leurs produits alimentaires en réduisant la « distance » entre l’entreprise de production agricole et le consommateur, et ce selon trois dimensions :
1) géographique en cherchant à « reterritorialiser » l’alimentation ;
2) relationnelles en cherchant à réduire le nombre d’intermédiaires entre les personnes qui produisent et celles qui consomment ;
3) cognitives en rendant plus perceptible le lien entre les produits agricoles et l’alimentation, en travaillant de façon plus artisanale et en liant le temps et l’espace avec des produits locaux et de saison.
Dans cette étude, nous avons cherché à cerner les enjeux de commercialisation des fermes de proximité et évaluer la faisabilité organisationnelle et économique d’un appui à la mise en oeuvre d’outils de mutualisation de certaines activités, à la fois dans le but d’améliorer la productivité et aider à servir de nouveaux marchés, incluant l’approvisionnement institutionnel.
Plusieurs résultats sont intéressants. Les agricultrices et les agriculteurs interrogés se montrent plutôt optimistes sur l'avenir des circuits courts, ils estiment que ces derniers ne s'en sortiront pas en imitant les circuits longs, mais bien en misant sur leurs spécificités. Nous avons comparé l'évolution des prix déclarée par nos répondants durant la pandémie et celle-ci apparaît nettement inférieure à l'inflation alimentaire moyenne mesurée par Statistique Canada. L’écart le plus important (près 6 points de pourcentage) a été observé en 2022. Selon plusieurs observateurs, cette augmentation modérée des prix ne reflète pas tant l’accroissement des coûts de production que la crainte de perdre des clients avec des hausses plus marquées.
Nous estimons que l’État pourrait progressivement compléter sa Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois (SNAAQ) afin que cette dernière affine les objectifs assignés aux gestionnaires et fasse mieux la différence entre l’achat de produits locaux, issus d’artisans ou de fermes de proximité, et l’approvisionnement en produits québécois qui ne se distinguent pas forcément par leur mode de production et par leurs impacts économiques et sociaux sur le développement territorial.
Titulaire
Aperçu
Les effets des activités agricoles sur l’environnement (eau, sol, biodiversité, changements climatiques) sont de mieux en mieux documentés et soulèvent des préoccupations sociétales. Dans ce contexte, les politiques agricoles s’ajustent, les réglementations se renforcent, des aides financières pour aider les entreprises à s’adapter et améliorer leurs pratiques sont offertes, des instruments économiques se développent, etc. Le choix des politiques et des meilleures façons de les mettre en œuvre reste un défi devant la complexité des enjeux agroenvironnementaux.
La professeure Marie-Ève Gaboury-Bonhomme mène et participe à des projets de recherche en lien avec les politiques agroenvironnementales et s’intéresse particulièrement à leur conception et à leur mise en œuvre. Elle est activement engagée dans le Réseau québécois de recherche en agriculture durable (RQRAD).
- 2022-2026 : Pratiques pour réduire l’utilisation des pesticides de synthèse au Québec : étude sociopolitique et macroéconomique des effets, des freins et des incitatifs, en collaboration avec plusieurs chercheurs de différentes universités et centres de recherche, financé par le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies.
- Depuis 2020 : Direction du mémoire de maîtrise de William Bernard, qui porte sur les politiques d’appui au développement des technologies agricoles vertes dans le contexte canadien.
- Depuis 2020 : Différentes études exploratoires sur les processus délibératifs, de co-construction des politiques publiques, ainsi que sur leur mise en œuvre considérant, entre autres, la transition agroécologique du secteur agricole
Titulaire
Aperçu
Le secteur agricole est soumis à des aléas climatiques (gel, grandes chaleurs, sécheresse, inondations, ouragans, etc.) pouvant causer d’importants dégâts aux cultures et occasionner des pertes de revenu pour les entreprises. Dans le contexte actuel de changements climatiques et de hausse des événements extrêmes, ces pertes potentielles prennent une place encore plus importante dans les choix de stratégies des gestionnaires agricoles pour bien gérer leurs risques. Certaines de ces stratégies relèvent de l’autogestion de leurs risques, d’outils dits privés ou encore d’assurances et des programmes gouvernementaux. L’assurance récolte est une politique publique majeure et en croissance en Amérique du Nord. C’est un programme dont la mise en œuvre est complexe et dont le taux d’adhésion varie selon les territoires, les modalités des programmes, et les secteurs/cultures.
La professeure Marie-Ève Gaboury-Bonhomme développe une programmation de recherche sur l’assurance récolte et la gestion des risques climatiques en agriculture. Elle s’intéresse plus particulièrement au programme québécois et aux facteurs subjectifs qui influencent les stratégies de gestion des risques climatiques au sein des entreprises agricoles.
- 2021-2023 : Étude sur la compréhension des choix des gestionnaires agricoles sur la gestion des risques associés aux pertes de culture (revue de littérature, enquête et entrevues semi-structurées), en collaboration avec Jacinthe Cloutier, projet financé dans le cadre du Concours ministère des Finances du Québec et CIRANO.
- 2020-2023 : Groupes de discussion avec des producteurs.trices agricoles et Delphi avec des experts québécois pour mieux comprendre les facteurs expliquant l’adhésion des entreprises agricoles aux programmes d’assurance récolte, en collaboration avec Annie Royer, Jacinthe Cloutier et William Robitaille.
- Depuis 2021 : Direction du mémoire de maîtrise de William Robitaille, qui compare la mise en œuvre des programmes d’assurance récolte dans le foin et le pâturage au Québec en Pennsylvanie.
Titulaire
Aperçu
Le projet « Accompagne » est financé par l’entremise du programme Innov’Action Agroalimentaire, en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Ce projet vise la réalisation de trois principaux objectifs :
- Déterminer le niveau de connaissances et les perceptions des entrepreneurs agricoles et de leurs partenaires financiers à l'égard des dispositifs d'accompagnement;
- Déterminer l'impact des dispositifs sur les modalités de financement des entreprises agricoles;
- Accompagner la relève agricole dans la mise en place de conseils consultatifs et évaluer les retombées.
Ce projet propose dans une première phase de validation de réaliser une enquête, via questionnaires-web, auprès de directeurs de comptes agricoles d'institutions financières ainsi que de leurs clients afin de déterminer (i) leur niveau de connaissances et leurs perceptions à l'égard des principaux dispositifs d'accompagnement ainsi que (ii) les retombées de l'utilisation tels des dispositifs sur les modalités de financement offertes aux entrepreneurs agricoles.
Dans une deuxième phase, une recherche-intervention auprès d'entrepreneurs de la relève agricole sera réalisée. Celle-ci visera à mettre en place, à assurer le suivi et à évaluer les retombées de conseils consultatifs à titre de dispositif d'accompagnement. Au cours de cette deuxième phase, les participants seront initiés à la mise en place d'un conseil consultatif puis accompagnés dans l'implantation d'un tel dispositif dans leur entreprise pour une durée d'un an (recrutement des membres, planification des rencontres, accompagnement lors des rencontres, réalisation des synthèses des rencontres). L'évaluation des impacts du conseil consultatif sur l'entreprise et l'entrepreneur ainsi que de la satisfaction des entrepreneurs et des membres du conseil sera réalisée à la fin de l'année d'implantation.
Titulaire
Aperçu
Des recherches récentes ont démontré que les producteurs agricoles tout comme les dirigeants des grandes entreprises sont encadrés, influencés, mais également contraints dans leurs choix stratégiques par un système de gouvernance constitué de parties prenantes diverses et de mécanismes variés de pilotage et de contrôle. La forte croissance de certaines de ces entreprises semble, elle aussi, se réaliser via un processus de formalisation de leur gouvernance et ce malgré l’absence d’ouverture du capital.
Ainsi, tel que démontré dans les start-ups, nous avons cherché dans ce projet à vérifier l’hypothèse que les dirigeants des entreprises agricoles qui souhaitent croitre de façon importante doivent être prêts à accorder un rôle important à certaines parties prenantes, via notamment des structures formalisées de gouvernance pour être en mesure de soutenir au mieux la croissance de leur entreprise.
C’est cette phase spécifique de transition au cours de laquelle les propriétaires-dirigeants choisissent de formaliser la gouvernance de leur exploitation qui fera l’objet du présent projet. En s’inspirant des recherches réalisées dans les petites entreprises, les entreprises familiales, de même que les entreprises en croissance, notre étude vise à préciser le processus de formalisation et les facteurs menant à sa mise en place en l’absence d’ouverture du capital au sein des entreprises agricoles. Ce projet, financé par la Chaire de recherche en gouvernance de sociétés, a ainsi permis d'approfondir les connaissances sur le processus de formalisation de la gouvernance, en précisant comment et pourquoi le dirigeant entame cette démarche via la réalisation de trois principaux objectifs :
- Identifier les mécanismes intentionnels et spécifiques mis en place dans les exploitations agricoles de même que leur modalité de fonctionnement (le quoi ?) ;
- Établir les conditions préalables à cette mise en place (le pourquoi ?) ;
- Proposer un modèle présentant le processus de formalisation de la gouvernance (le comment ?).
Une synthèse des résultats du projet est maintenant disponible sur cette page
Titulaire
Aperçu
L’agriculture est à la fois une branche de l’économie, un secteur professionnel et un ensemble de pratiques ayant pour objet principal la production de produits végétaux et animaux. Au Canada, comme dans le reste de l’Amérique du Nord et en Europe, les recensements agricoles retiennent des définitions de l’exploitation agricole larges et inclusives, dans le sens où toute entité produisant des produits agricoles dans l'intention de les vendre est recensée comme exploitation agricole (Statistique Canada, 2016).
Mais tous les détenteurs d’une exploitation agricole au sens statistique du terme sont-ils pour autant des agriculteurs ? Cette question est importante dans le sens où ce statut professionnel donne accès à divers droits, notamment celui de bénéficier des politiques agricoles.
Au Québec, on constate une polarisation de la taille des exploitations agricoles avec un maintien relatif du nombre de petites fermes et l’accroissement du nombre de grandes fermes. Cette polarisation témoigne d’un renouvellement de la population agricole avec l’arrivée dans ce secteur de personnes inscrivant leur projet d’établissement en agriculture dans un projet de vie plus large ou d’investisseurs avec un projet économique. Mais aucune recherche ne s’est encore penchée sur la façon dont les principaux intéressés positionnent eux-mêmes leur projet dans le développement de l’agriculture. Aucune recherche ne s’est non plus intéressée à la relation entre le droit (qui définit ce qu’est un producteur agricole) et les identités professionnelles des agriculteurs québécois dans leur variété.
Mobilisant des concepts issus de la sociologie du travail et du droit, notre projet vise à :
- qualifier les identités professionnelles qui caractérisent les agriculteurs québécois,
- évaluer la façon dont les agriculteurs québécois inscrivent leur projet dans le développement de leur secteur professionnel et de leur territoire,
- vérifier l’adéquation entre les définitions juridiques du statut professionnel et les référents sociaux et professionnels des agriculteurs.
Notre projet repose sur l’hypothèse que la réalité de l’agriculture québécoise est plus complexe et diverse que la représentation qui en est faite autour d’un noyau central et légitime représenté par l’agriculture familiale professionnelle, encadré à ses deux extrémités par une agriculture de loisir non rentable et non professionnelle d’un côté et une agriculture capitaliste, financiarisée et non familiale de l’autre.
Pour remplir nos objectifs, notre projet se décline en deux volets complémentaires : une enquête qualitative auprès d’agriculteurs dans divers contextes visera à cerner leur identité professionnelle dans toutes ses dimensions et une étude juridique examinera comment la diversité interne de l’agriculture québécoise est prise en compte par l’encadrement juridique et normatif définissant le producteur agricole et par les lois et règlements définissant les critères d’accès aux politiques agricoles.