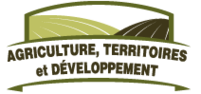Enjeux de rentabilité et besoins des exploitations agricoles de petite taille en matière de commercialisation et distribution de leurs produits
- Période: 2023-04-06 2024-06-30
Aperçu
Les « fermes de proximité » qui pratiquent la vente directe sans aucun intermédiaire entre le producteur et le consommateur représentaient 21 % de toutes les fermes québécoises en 2021 comparativement à 19 % en 2016 selon les données les plus récentes. Les initiatives de mise en marché rapprochant le consommateur du producteur font l’objet d’un intérêt renouvelé au Québec comme ailleurs, tant de la part des acteurs de l’agriculture que des pouvoirs publics ou des consommateurs. Ces initiatives visent généralement à offrir aux consommateurs une façon alternative d’acquérir leurs produits alimentaires en réduisant la « distance » entre l’entreprise de production agricole et le consommateur, et ce selon trois dimensions :
1) géographique en cherchant à « reterritorialiser » l’alimentation ;
2) relationnelles en cherchant à réduire le nombre d’intermédiaires entre les personnes qui produisent et celles qui consomment ;
3) cognitives en rendant plus perceptible le lien entre les produits agricoles et l’alimentation, en travaillant de façon plus artisanale et en liant le temps et l’espace avec des produits locaux et de saison.
Dans cette étude, nous avons cherché à cerner les enjeux de commercialisation des fermes de proximité et évaluer la faisabilité organisationnelle et économique d’un appui à la mise en oeuvre d’outils de mutualisation de certaines activités, à la fois dans le but d’améliorer la productivité et aider à servir de nouveaux marchés, incluant l’approvisionnement institutionnel.
Plusieurs résultats sont intéressants. Les agricultrices et les agriculteurs interrogés se montrent plutôt optimistes sur l'avenir des circuits courts, ils estiment que ces derniers ne s'en sortiront pas en imitant les circuits longs, mais bien en misant sur leurs spécificités. Nous avons comparé l'évolution des prix déclarée par nos répondants durant la pandémie et celle-ci apparaît nettement inférieure à l'inflation alimentaire moyenne mesurée par Statistique Canada. L’écart le plus important (près 6 points de pourcentage) a été observé en 2022. Selon plusieurs observateurs, cette augmentation modérée des prix ne reflète pas tant l’accroissement des coûts de production que la crainte de perdre des clients avec des hausses plus marquées.
Nous estimons que l’État pourrait progressivement compléter sa Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois (SNAAQ) afin que cette dernière affine les objectifs assignés aux gestionnaires et fasse mieux la différence entre l’achat de produits locaux, issus d’artisans ou de fermes de proximité, et l’approvisionnement en produits québécois qui ne se distinguent pas forcément par leur mode de production et par leurs impacts économiques et sociaux sur le développement territorial.