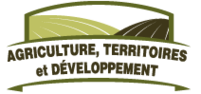Ethier, Marilou

Étudiante au doctorat en agroéconomie
Titulaire d’un baccalauréat en agroéconomie de l’Université Laval, Marilou a travaillé dans la fonction publique ainsi qu’au département d’économie agroalimentaire et sciences de la consommation en tant qu’auxiliaire d’enseignement et de recherche.
Durant sa maîtrise, elle s’est intéressée aux capacités financières qu’aura la future relève agricole québécoise à intégrer le secteur pour combler les nombreux départs à la retraite prévus d’ici 2035. Son mémoire s’intitule « Comment la relève agricole québécoise financera-t-elle son établissement en 2035? Une approche prospective de l’évolution du gap de financement ».
Son projet doctoral porte sur les initiatives québécoises qui s’inscrivent dans des systèmes alimentaires alternatifs. Le système alimentaire dominant, industriel et hautement spécialisé, expose différentes limites socio-environnementales (Anderson et al., 2019) qui remettent en question sa durabilité. En contrepartie, des initiatives locales, régionales et nationales s’inscrivent dans des systèmes alimentaires qui se veulent alternatifs à ce modèle dominant (Le Velly, 2019). Ces initiatives poursuivent des objectifs variés, mais la plupart défendent une approche agroécologique, c’est-à-dire qu’elles adoptent une vision holistique de l’écologie dans les systèmes alimentaires (Wezel et al., 2015). La transition vers des pratiques agroécologiques se présente sous diverses formes, parfois davantage reliées à l’intégration de pratiques innovantes au niveau technologique, parfois s’approchant plutôt de l’artisanat écologique (Anderson et al., 2019). Si la transition des systèmes alimentaires conventionnels vers des modèles agroécologiques semble de mise, le pouvoir de transformation des initiatives alternatives sur le système dominant reste peu étudié au Québec. Le cadre théorique choisi postule que les initiatives alternatives (les niches) doivent se structurer pour influencer le régime actuellement dominant. Ces alternatives, souvent innovantes, se développent dans un contexte socio-économique, politique et culturel fortement capitaliste adapté au régime dominant. Les niches qui émergent se heurtent ainsi à plusieurs verrous qui affectent leur développement et même leur survie. Pourtant, la multiplication des initiatives et leur grande diversité, témoignent d’une forte vitalité. Dans ce contexte, il semble important de s’intéresser à leur capacité à se structurer afin de comprendre leur aptitude à influencer les systèmes alimentaires conventionnels. Ainsi, l’objectif de ce projet de recherche est de considérer l’ensemble des projets alternatifs québécois, publics ou privés, qui s’inscrivent dans les systèmes alimentaires non conventionnels, et d’évaluer leur potentiel à s’organiser pour influencer les systèmes alimentaires dominants
:
Titulaire d’un baccalauréat en agroéconomie de l’Université Laval, Marilou a travaillé dans la fonction publique ainsi qu’au département d’économie agroalimentaire et sciences de la consomntmation en tant qu’auxiliaire d’enseignement et de recherche.
Son projet de maîtrise porte sur le financement de la nouvelle relève agricole québécoise lors de son établissement et s'intitule : Besoins financiers et offres de financement de la nouvelle relève agricole québécoise. À l’instar de la population québécoise, l’âge moyen de la population agricole augmente. Le taux de renouvellement souhaitable pour assurer la pérennité et la diversité du secteur agricole est de 50 %. Or, en 2021, ce taux était de 16 % au Québec. Les établissements en agriculture ne suffisent pas à combler les départs à la retraite. Cette tendance menace le secteur agricole, de même que la société québécoise dans son ensemble. Il est ainsi primordial d’analyser le visage de la relève agricole québécoise afin de la comprendre, de l’accompagner et de la voir foisonner.
La barrière à l’entrée la plus considérable lors de l’établissement en agriculture est sans équivoque la barrière de nature financière. Le visage de relève agricole s’actualise en réponse aux changements auxquels le secteur est confronté et à la complexification de cette barrière financière. La traditionnelle relève s’établissant par transfert familial est en déclin, le transfert d’entreprises agricoles hors cadre familial reste marginal, mais constant, tandis que l’établissement par démarrage d’une nouvelle entreprise est en croissance.
Cette nouvelle relève agricole mobilise divers types de financement afin de réaliser ses projets d’établissement. Traditionnellement, le don, l’emprunt bancaire, l’aide gouvernemental, la mise de fonds et le capital amical constituent les principales sources de financement. En contexte de transfert familial, le don occupe une place cruciale dans le montage financier de la relève. Lors d’un démarrage, l’emprunt est la principale source de financement. Bref, chaque caractéristique du visage de la relève agricole détermine plus ou moins les sources de financement accessibles et mobilisées.
Le projet de maîtrise propose ainsi d’explorer s’il existe une adéquation entre les besoins financiers et les offres de financement de cette nouvelle relève agricole québécoise au moment de son établissement.