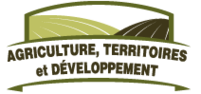Guesthier, Mathieu

Étudiant à la maîtrise sur mesure en analyse socioéconomique de l'agroécologie
:
C’est après plusieurs années en tant que musicien professionnel que Mathieu a regagné les bancs d’école. Attiré par le développement durable, la production animale et les technologies agroenvironnementales, il a complété un baccalauréat multidisciplinaire parfaitement aligné avec ses ambitions, à l’Université Laval. Après la réalisation d’un microprogramme en agroécologie, le voilà aujourd’hui étudiant-chercheur à la maîtrise sous la direction de Patrick Mundler. Mathieu se consacre aujourd’hui à la transition agroécologique du système agroalimentaire, aux interactions entre l’agriculture et le territoire, mais particulièrement aux nouveaux mouvements sociaux s’inscrivant dans ces phénomènes agraires. Son projet de recherche porte sur l’étude d’un nouveau mouvement social idéologique intimement lié à l’agriculture domestique : les autosuffisants domestiques du Québec.
À travers le monde moderne, les adhérents à ce mouvement cherchent à s’affranchir du complexe politico-industriel (le Système) en adoptant un ensemble de pratiques visant l’autarcie, l’autonomie, la débrouillardise, l’indépendance et la liberté (Ford, 2019). D’ailleurs, l’autosuffisance domestique se revêt d’une allure spirituelle, frôlant parfois le rituel (Gould, 1997). Bien que cette quête d’émancipation repose sur une diversité d’initiatives, l’autosuffisance domestique s’articule toujours autour de deux piliers fondamentaux : l’agriculture domestique et les techniques de conservation.
En respect des définitions fournies par Gliessman (2018) et Wezel et coll. (2009), l’autosuffisance domestique peut aussi être appréhendée comme un mouvement agroécologique, car :
- Elle incarne une forme de résistance passive aux modèles dominants, tout en ayant une portée revendicatrice;
- Elle critique l’hégémonie du système agroindustriel et ses impacts socioécologiques;
- Elle prône et défend la sécurité alimentaire, la souveraineté et l’autonomie;
- Derrière son apparente individualité, elle fédère une communauté grandissante et continue de gagner en popularité;
- Elle est fondamentalement orientée vers l’action et se structure autour d’un ensemble de pratiques concrètes.
Enfin, peu d’études ont été réalisées sur les autosuffisants au Canada – encore moins dans notre belle province. Que sait-on vraiment des autosuffisants québécois?
- Leurs valeurs, motivations et préoccupations se rapprochent-elles de celles des back-to-the-landers étatsuniens (Brown, 2011) ou des autres autosuffisants des pays modernes?
- Quelles sont les pratiques d’autosuffisance domestiques?
- Privilégient-ils réellement des approches agroécologiques?
- Quelles sont les caractéristiques économiques des ménages autosuffisants québécois?
Une enquête in situ sur ce nouveau mouvement agroécologique permettra de mieux comprendre ces individus et ces familles. Pour ce faire, une ethnographie ancrée, combinant observations participantes et entretiens semi-dirigés, explorera ces questions en profondeur. Cette approche contribuera à mieux cerner les motivations, les valeurs et les pratiques des autosuffisants domestiques d’ici, tout en offrant un regard nuancé sur leur rôle dans le paysage socioéconomique et agroécologique québécois.
Bibliographie
Brown, D. (2011). Back to the land : The enduring dream of self-sufficiency in modern America. University of Wisconsin Press.
Ford, A. (2019). The Self-sufficient Citizen : Ecological Habitus and Changing Environmental Practices. Sociological Perspectives, 62(5), 627‑645. doi.org/10.1177/0731121419852364
Gliessman, S. (2018). Defining Agroecology. Agroecology and Sustainable Food Systems, 42(6), 599‑600. doi.org/10.1080/21683565.2018.1432329
Gould, R. K. (1997). Modern Homesteading in America : Religious Quests and the Restraints of Religion. Social Compass, 44(1), 157‑170. doi.org/10.1177/003776897044001012
Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., Francis, C., Vallod, D., & David, C. (2009). Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy for Sustainable Development, 29(4), 503‑515. doi.org/10.1051/agro/2009004